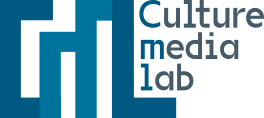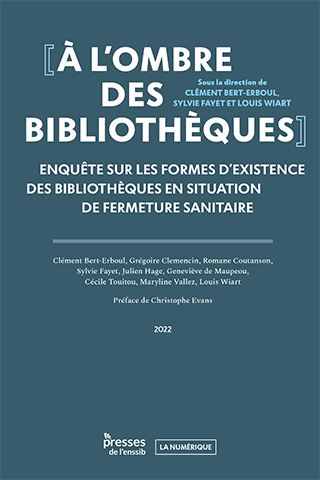Dans cet entretien que Muriel Amar et Julien Hage ont accordé au Culture Media Lab. Ils y évoquent les conclusions de leur recherche À l’ombre des Bibliothèques, parus sous forme de livre.
Muriel Amar, Julien Hage, vous participez, avec huit autres chercheurs et professionnels de bibliothèques, au projet de recherche À l’Ombre des bibliothèques : enquête sur les formes d’existence des bibliothèques en situation de fermeture sanitaire, mené à la suite du premier confinement. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur chacun de vous ?
MA : Mon premier métier est conservatrice des bibliothèques, j’ai travaillé essentiellement à la Bibliothèque nationale de France et à la Bibliothèque publique d’information ; j’ai pendant neuf ans contribué à la mission d’enseignement du Pôle Métiers du livre de Saint-Cloud (Paris Nanterre) en tant que professionnelle ; je suis aujourd’hui maîtresse de conférences en Infocom au Pôle Métiers du livre à Saint-Cloud, associée au laboratoire Dicen-IdF.
JH : Je suis maître de conférences en Infocom, chercheur associé au Dicen-IdF, directeur du département Infocom du Pôle Métiers du livre. J’étais un historien du contemporain, du livre, de l’édition, de l’imprimé à l’ère numérique. J’en suis venu à enseigner dans les formations métiers du livre et à envisager l’éditorialisation, les dispositifs éditoriaux d’une manière un peu plus professionnelle et professionnalisante, intégrer cette démarche-là et cette focale-là dans mon travail de recherche.
Mars 2020, c’est le confinement en France. Quel a d’abord été votre réflexe à la fois personnel et ensuite de chercheurs et de chercheuses quand vous avez vu cette situation nouvelle arriver ? À quoi avez-vous pensé ?
JH : La première chose qu’on a faite, c’est tenir les murs à distance. Nous sommes responsables d’unité, directeur d’études. Il fallait tenir les murs avec les étudiants à distance, alors même que les murs venaient de s’écrouler, d’une certaine manière. Ça nous a touchés alors qu’on était au milieu du semestre, qu’on se dirigeait vers les stages. L’objet sur lequel nous nous sommes penchés, La bibliothèque solidaire du confinement, n’a pas été la destination directe de notre intérêt, tous occupés que nous étions au sauve qui peut pédagogique. Et seulement quand nous avons pu entrevoir, rétablir du lien, plus qu’une quelconque « continuité », à l’aide des outils numériques, alors nous nous sommes intéressés à ce qu’il se passait sur Internet.
MA : À l’époque, j’étais encore conservatrice des bibliothèques et je faisais habituellement du service public à la Bpi toutes les semaines. A la fermeture de la Bpi pendant le confinement, je me suis retrouvée en télétravail sur mes tâches internes, mais je me suis tout de suite inscrite sur une plateforme qui s’appelle Solidarité numérique, comme une continuité du service public que je faisais habituellement, cette plateforme téléphonique met à disposition un contact et des ressources pour permettre aux gens de faire aboutir leurs démarches numériques. J’avais l’impression de continuer à faire mon métier de bibliothécaire. Ce n’était pas quelque chose qui était dans mon temps de travail officiel. À aucun moment je n’ai pensé qu’il existait quelque chose de collectif autogéré comme La bibliothèque solidaire du confinement.
Tenir les murs. Tout d’un coup, vous avez découvert ces linéaires nouveaux et en développement, en partage, de bibliothèques qui étaient créés sur Internet. Comment avez-vous découvert cet objet de recherche, ce groupe Facebook donc ?
MA : Le comité éditorial des Presses de l’Enssib dans lesquels s’inscrit la collection La Numérique dont je m’occupe m’a demandé de faire quelque chose sur le confinement et les bibliothèques. Au milieu de tout ce qui se mettait en place, dans ce qui était entrepris par les bibliothèques notamment les négociations avec les éditeurs ou les modalités de communication en ligne avec les usagers, je ne percevais pas ce qu’il y avait de spécifique au confinement. Je voulais au début travailler sur Solidarité numérique mais en réfléchissant, en cherchant, en discutant avec les uns et les autres, j’ai compris que ce groupe Facebook La Bibliothèque solidaire du confinement, son étude, pouvait nous aider à déployer une réflexion commune autour de bibliothèque et confinement, autrement.
Quelle a été l’intuition première de la recherche ?
MA : Je m’intéresse aux formes d’existence de la bibliothèque, dans, à travers et à la lisière des institutions publiques. L’idée était au début de faire un travail sur les alternatives informelles mises en place par les usagers. Il y avait BSC, les salons Zoom et d’autres initiatives plus modestes. Petit à petit, on s’est rendu compte que tout cela était très structuré, très structurant et très inspirant, et très susceptible de pouvoir faire travailler beaucoup de gens différents ensemble. Dans cette collection, c’est quelque chose qui m’intéresse beaucoup : travailler et faire travailler en collectif, avec des réussites et des échecs, bien sûr.
Comment est-ce que ce groupe permet de penser la bibliothèque et ses pratiques lorsqu’elle est ouverte, ce qui y manque et la manière dont les usagers privés de présence physique peuvent se réapproprier des outils communs ?
JH : Ce qui est très intéressant dans la genèse de BSC, c’est ce qui en elle relève des bibliothèques et ce qui en elle ne relève pas des bibliothèques. On est là un peu au-delà de l’hybridation. Les fondateurs et administrateurs arrivent à se constituer en bibliothèque, à s’institutionnaliser en évitant les querelles. C’est au-delà d’un community management bien ordonné, parce qu’ils se structurent autour de l’idée que la recherche est empêchée mais qu’il faut exister, qu’il faut continuer à travailler, dans ce contexte d’isolement et de fermeture des ressources. De ce point de vue-là, ils font bibliothèque dans la nécessité qu’ils ont de trouver les documents et de les échanger. Et dans ce partage documentaire, est absente une dimension de disputes sur le niveau des livres, les auteurs de référence face aux plus discrets. Et ça, c’est très bibliothécaire ! Un autre aspect qui est et qui n’est pas bibliothèque, c’est cette manière de « voir les savoirs », pour reprendre le titre du livre de Jean-François Bert et Jérôme Lamy. BSC est, en ce sens, une formidable « boîte noire » des pratiques et de la littératie numérique en matière scientifique. On a une vue sur des pratiques savantes très étonnantes. On voit comment les gens fonctionnent : par un partage documentaire qui se structure progressivement. D’abord, les gens s’échangent des photographies de bibliothèques physiques sur les réseaux sociaux. Et ensuite, ils commencent à s’échanger des ressources numériques de plus en plus spécifiques, de plus en plus complexes. C’est tout à fait passionnant parce qu’il y a là une manière de voir la science se faire et de venir voir la science se faire. Il y a ceux qui font des demandes, il y a ceux qui y répondent et il y a ceux qui sont au spectacle des demandes. De ce qui se passe, de ce qui se lit, de ceux qui travaillent. Et ça, c’est relativement inédit. C’est un échange qui a lieu habituellement dans une salle de bibliothèque « je cherche tel livre pour travailler sur tel sujet » et là un groupe Facebook dans lequel des milliers de personnes se regardent, reproduit cet échange et le met à l’écoute.
Comment avez-vous étudié le groupe, avec quels autorisation et accès, accueil même, de la part de ses administrateurs et administratrices ?
MA : Nous avons contacté les administrateurs sans connaître leur nombre – ils ont été jusqu’à 10 personnes impliquées. Nous leur avons présenté notre projet. Ils ont lancé un sondage à l’ensemble de la communauté pour permettre la récupération des données (par scrapping ou API, notre choix d’outil était alors incertain) et rentrer en contact avec des membres du groupe pour des entretiens qualitatifs, donc d’assez longue durée. Le sondage est resté une semaine en ligne avec plus de 1500 votes qui se sont avérés très favorables au projet ; des membres se sont interrogés sur la visibilité qu’allait donner le livre à ce positionnement du groupe, malin, qui consiste à mettre en rapport des gens sans transfert public de fichier. S’il y a spectacle, c’est la coulisse qui est à imaginer, à restituer, aussi dans l’après-coup, l’après-confinement. D’autres groupes, comme AskAPDF, ou des bibliothèques pirates, font le choix inverse de stocker des fichiers et sont régulièrement chassés du Web.
Le livre est composé de parcours et les textes qui désignent des usages différents, des enjeux du groupe. Quels sont les plus marquants ?
JH : On peut constater aussi de vraies évolutions, influencées par la pratique du groupe, dans les savoir-faire numériques. Un exemple que je cite souvent, c’est celui de quelqu’un qui avait posté une photo de sa bibliothèque physique en proposant de scanner des extraits. Cette personne, deux ans après, demande aux membres de lui recommander les meilleurs logiciels de gestion de bibliothèque numérique, une pratique nouvelle pour lui. C’est un vrai transfert de savoir-faire, une démocratisation et de développement de ce que j’appelle le « collectionnisme savant » au sens de Joëlle Le Marec, des gens qui vont constituer des bibliothèques de centaines de volumes dont ils n’avaient ni l’usage, ni l’intérêt avant ce moment. Pour autant, il y a tous les types de politicité dans BSC -pêle-mêle, l’idéologie hacker, le féminisme, l’éducation populaire…- mais dans le groupe, on fonctionne sur un mode de consensus implicite que j’ai appelé « Économie morale de la science » à la manière de Lorraine Daston, c’est-à-dire que pour travailler, il faut des documents, il faut se les échanger, il faut avoir ce mode d’entraide minimale et c’est ça qui motive une pratique qui est transgressive, qui, elle, n’est jamais explicitée, ni plébiscitée, ni mise en discours. Cette pratique de courtage documentaire collectif en ligne se rapproche des réseaux d’échanges réciproques de savoirs de l’éducation populaire de la période précédente. Il n’y a pas de débat dans le groupe sur une éthique à cœur, les biens communs de la connaissance. On trouve très peu de genre de choses.
MA : Aujourd’hui, on va dans BSC pour faire un diagnostic documentaire à partir d’un sujet, d’une demande, d’un auteur et éventuellement, il y a un échange de fichiers. Il y a plein d’interactions documentaires qui ne sont pas finalisées, des questions sans fichiers, des propositions de fichiers sans receveurs… Ce n’est pas un marché noir de la science, un pillage ou un militantisme des communs. C’est quelque chose de beaucoup plus pragmatique, une forme de plaidoyer pour la valeur d’usage du livre.
JH : En effet, il y a énormément de demandes orphelines. Le groupe, malgré ses tentatives, ne parviendra jamais à vraiment établir une indexation. Et comme le dit un des auteurs, Grégoire Clémencin dans son texte, « Il n’y a pas de mémoire du groupe. ». Les livres qui sont les plus demandés sont souvent des classiques, comme La distinction de Bourdieu.
Mais si le groupe n’a pas de mémoire, votre livre ne lui en offre-t-il pas une ? Il est distribué, aussi, en numérique, et gratuitement. Pourquoi l’avoir distribué comme cela ?
MA : Je suis contente que vous fassiez le lien avec la question de la mémoire parce que c’était une des idées : il faut que reste quelque chose de ce groupe, de ces 70 000 membres qui se sont dit : « On va faire quelque chose ensemble. » Nous voulons garder des traces de ce qui se passe sur des espaces numériques extrêmement labiles, très fluctuants, très difficiles à lire, très difficiles à comprendre. Voilà l’idée de la collection La numérique. Essayer de proposer une rétention sur des phénomènes, de les stabiliser, de fixer des états des lieux des pratiques et des acteurs.
JH : C’est très surprenant. On a, à l’origine, un groupe de chercheurs, plutôt en doctorat ou en post-doctorat, dans des disciplines très pointues comme l’anthropologie, l’archéologie, l’histoire de l’art et il leur faut vraiment une bibliographie de référence de recherches très pointues ; et notamment en langues étrangères. L’un des enseignements du travail sur Bibliothèque solidaire du confinement, c’est aussi de voir une demande très concrète d’une bibliographie anglosaxonne qui ne se trouve pas nécessairement dans les bibliothèques de recherche françaises et pas nécessairement dans les bibliothèques de lecture publique. Il y a des effets de demande qui sont matérialisés. Et ces acteurs-là, quand les bibliothèques de recherche vont rouvrir, ils vont y retourner et être un peu moins présents dans le centre de gravité de l’activité du groupe. Et ce sont des gens qui étaient plutôt au spectacle, des masterants, qui étaient un peu plus discrets, qui regardaient, qui prennent la main ensuite. Et des amateurs aussi.
On trouve cette analyse dans le livre mais aussi des témoignages…
MA : Oui, on veut rendre compte de ce moment-là avec, dirait-on, un regard de fourmi, et une perspective à 360 degrés du sujet. C’est un ouvrage très polyphonique, distribué en parcours qui sont autant de regards et de chemins différents. Il y a des analyses (menés avec différentes approches) mais aussi des récits écrits par les membres eux-mêmes. Nous avons contacté énormément de personnes. Toutes n’ont pas donné suite. Nous avons réalisé des entretiens approfondis avec une dizaine de membres qui ont fait l’objet de portraits. Et des textes écrits pendant le confinement, comme ceux de Joëlle Le Marec, Charles Parisot-Sillon, Dan Sperber . Enfin, il y a toute la partie méthodologique, la constitution d’une base de données qui est issue du scrapping du groupe Facebook, qu’a faite Grégoire Clémencin, qui a permis un traitement textuel et statistique. C’est cela travailler sur un objet Web, sur des questions de bibliothèques et sur un moment inédit de l’histoire, dans le dialogue entre chercheurs et professionnels.
JH : Et en donnant la parole aux acteurs, en la restituant sans être dans une forme de surplomb ou de positivisme béat.
Quel est le devenir aujourd’hui du livre ? Vous le présentez lors de conférences, des rencontres, dans des bibliothèques. C’est intéressant, pour ce qui est d’un livre numérique. Aussi, l’avez-vous diffusé sur le groupe BSC ?
MA : Nous sommes restés en contact étroit de toute manière avec les administrateurs pendant toute la durée du travail. Ils ont été les premiers informés de la mise en ligne et ils sont invités à toutes nos interventions. Pour l’instant, ils ne sont jamais venus.
JH : Ou alors discrètement ? Aussi discrètement qu’ils agissent en ligne. C’est un vrai paradoxe : Pourquoi Facebook ? Dispositif robuste, de l’ordinaire, du temps perdu, du temps retrouvé, de la rupture de l’isolement. Pourquoi avoir une démarche de ce style en la plaçant sur Facebook ?
Peut-être parce que ce réseau s’appelle Le visage et le Livre.
MA : (rires). C’est vrai. Notre livre est diffusé sur Open Édition Books. C’est une manière d’être pleinement en phase avec notre objet. C’est une vraie question celle du gratuit et de sa valeur.
JH : Le monde de demain, c’est penser ce qui nous est arrivé au moment du confinement. Comme on psalmodie les mots de continuité. Quand on est responsable d’une charge éducative et pédagogique, scientifique et collective, on voit bien les effets du confinement. Ce gratuit vient aussi dire qu’il faut traverser, dépasser la société qui dit qu’il faut continuer, qu’il faut être productif. Et ça, à mon avis, ça va aussi à rebours de beaucoup de discours dominants. BSC manifeste en actes que le savoir est un viatique, que la recherche se nourrit d’échanges, que la science est une intarissable source de curiosité. Même au plus noir de la pandémie, au revers des politiques d’austérité du monde académique. Ce livre participe d’abord de cette réflexion-là. Il a été conçu comme tel parce qu’on a joué avec les confinements.
Comment avez-vous travaillé ?
MA : Nous avons travaillé collectivement et pourtant, le collectif s’est instancié aussi à distance. C’était totalement inédit. Nous nous sommes retrouvés pendant un an, presque tous les vendredis soir, en ligne. C’était assez difficile parce que ça nous créait des contraintes. Vienne qui veut, vienne qui peut, le rendez-vous existait. La construction en ligne d’un projet collectif est un exercice extrêmement difficile parce que chaque mot, chaque parole pèse beaucoup. On y perd l’informel. Le travail était aussi en lui-même une expérience de recherche. Avoir éprouvé tout cela, personnellement, professionnellement, c’est extrêmement important pour comprendre la suite de ce que nous avons à vivre.
JH : Tous les auteurs se sont rencontrés après la fin du livre ! Aux levées des dispositifs sanitaires. Et je pense que c’est finalement le fait d’avoir écrit, d’avoir travaillé comme cela qui a amené la possibilité d’une mise en abîme dans nos parcours respectifs. Dans ma pratique d’enseignant, ça me fait réfléchir beaucoup plus, maintenant. Je comprends mieux comment fonctionnent mes étudiants dans leur rapport à la bibliographie. Ce qui nous a impressionné aussi dans ce projet, c’est de constater que les administrateurs du groupe avaient très vite compris que ça allait durer, ce confinement.
MA : Au 14 mars 2020, on ne savait pas qu’on en prendrait pour 2 mois. Ou deux ans en fait…
C’est vrai… Merci pour cet entretien et pour ce travail que nous encourageons chacun à consulter, pour cette période durant laquelle nous avons été nombreux et nombreuses à chercher nos marques, à en trouver de nouvelles dans notre rapport aux livres, à l’étude et à la documentation, au rapport empêché à l’autre surtout.
Liens
La page du projet de recherche À l’ombre des bibliothèques est accessible ici.
Le livre À L’OMBRE DES BIBLIOTHÈQUES Enquête sur les formes d’existence des bibliothèques en situation de fermeture sanitaire est téléchargeable ici.
Mots-clés
Les dernières actus